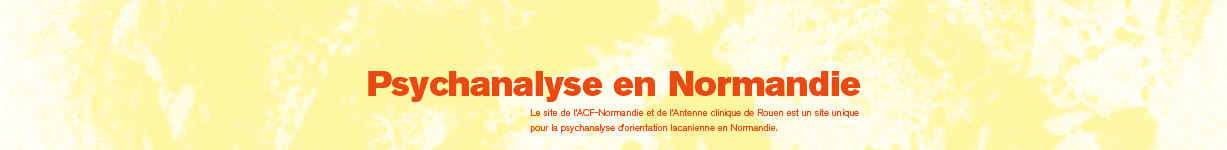ACF-NORMANDIE

- Présentation de l’ACF
-
Séminaires de l’ACF et activités des membres
- - ACF 2023-24 : les archives.
- - ACF 2022-23 : les archives.
- - ACF 2021-22 : les archives.
- - ACF 2020-21 : les archives.
- - ACF 2019-20 : les archives
- - ACF 2018-19 : les archives
- - ACF 2017-18 : les archives
- - ACF 2016-17 : les archives
- - ACF 2015-16 : les archives
- - ACF 2014-15 : les archives
- - ACF 2013-14 : les archives
- - ACF 2012-13 : les archives
- - ACF 2011-12 : les archives
- - ACF 2010-11 : les archives
- Cartels de l’ECF
Recherche
Par activités
- Activités ROUEN
- Activités LE HAVRE
- Activités EURE
- Activités CAEN
- Activités CHERBOURG
- Rouen archives
- Le Havre archives
- Eure archives
- Caen archives
- Cherbourg archives
- À ÉCOUTER
- AUTISME
Publié le lundi 9 octobre 2023
Les membres proposent... 2023-24
STUDIOLO - Lecture à plusieurs du livre d’Éric Laurent...
Les jeudis 28 sept., 23 nov., 21 déc. 2023, 8 février, 21 mars, 18 avril , 23 mai, 20 juin 2024 - 21h - Visioconférence

Lecture à plusieurs du livre d’Éric Laurent L’envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance
Plusieurs membres de l’ACF en Normandie se réunissent par zoom chaque mois pour lire ensemble et commenter le livre d’Éric Laurent, dans un aller et retour avec les textes de Lacan que lui-même commente.
S’en dégagent les perspectives nouvelles que le dernier enseignement de Lacan met à jour pas sans se référer à l’ensemble de son enseignement.
Ce 28 septembre 2023, nous avons poursuivi l’étude du livre d’Eric Laurent, où nous étions arrêtés à la page 171. Nous avons mis à l’étude quelques points importants, notamment l’idée que Lacan fait correspondre l’histoire avec le sens qui fuit. Nous y avons vu de même que ceux qui ont choisi de devenir des personnages, de participer à l’histoire, s’en sont fait un escabeau, mais en ont été aveuglés.
Par ailleurs, Éric Laurent place d’un côté le corps, le symptôme et de l’autre côté, le sens de l’histoire et la fuite que celui-ci comporte. Ainsi, il indique que le corps et son symptôme sont décalés par rapport au sens qui fuit. Ce qui est symptomatique, ce qui reste et ne fuit pas, ne peut s’appréhender par le sens.
Il a ensuite été question de s’interroger à partir des termes « déportés » et « les déplacés ». Cela a amené à échanges et discussion autour de la dimension de l’exode, qui est la face visible de la fuite de l’histoire. Joyce était un exilé avec une dimension de « sérieux » au sens de « ce qui fait série », répétition. Pour Joyce, il s’agit d’une certaine constance de son exil, sans soumission au sens, quelque chose qui ne participe pas à l’histoire. C’est l’exil hors sens.
Nous avons par la suite échangé concernant la dimension de l’habeas corpus, cité par E. Laurent. Dans sa définition, l’habeas corpus est ce qui renvoie à la liberté de l’individu, au contrôle qu’il doit avoir de son propre corps et de ses biens. « L’envers de l’habeas corpus » dont parle E. Laurent, intervient lorsqu’il n’y a pas le contrôle de son corps et de ses biens. C’est-à-dire que le corps, le symptôme, est d’un côté et le sens de l’histoire de l’autre. Le corps c’est ce qui résiste au sens. Il n’y a pas d’être du corps. Il n’y a qu’une relation d’avoir un corps et, il est compliqué de se représenter, qu’on ne peut pas se passer de l’image, qu’on est en adoration devant le corps…
Cet échange nous a permis de situer ce qui est du côté du corps avec son symptôme, à savoir son symptôme dans sa dimension réelle, et ce qui est du côté du sens de l’histoire des déportés, ceux qui choisissent l’histoire et son sens en quelque sorte.
Ainsi, cela nous a permis de préciser la phrase d’E. Laurent « puisque l’homme a un corps c’est par le corps qu’on l’a1 » : à savoir qu’à partir du moment où l’homme a un corps, c’est par le corps qu’il a le symptôme. Étant entendu que le corps renvoie au symptôme dans ce qui ne peut être pris dans le sens ou dans ce qui résiste au sens, et donc ne peut être traité par ça. Ce n’est pas le corps de l’habeas corpus, celui des biens, ni celui du symbolique, ni de l’imaginaire. C’est le corps du symptôme.
Et, cette dimension symptomatique du corps, qui ne peut s’attraper par le sens, ça les aveugle. C’est-à-dire que de monter sur cette scène-là, en prenant une certaine place historiquement visible et repérable par l’histoire, les aveugle. Nous parlons là du signifiant-maître, tout seul, dans sa percussion du corps et non pas le signifiant-maître produisant du sens ou ayant des effets de sens.
Dans son intertitre, Joyce trans, E. Laurent écrit que « Joyce ne se tient pour femme à l’occasion que de s’accomplir en tant que symptôme2 » et il précise trois points :
- être symptôme féminin,
- le symptôme hystérique, c’est s’intéresser au symptôme de l’autre comme tel. Qui est à différencier de « être symptôme pour un autre corps », sur le versant féminin. C’est un symptôme à la puissance 2 : le symptôme du symptôme. C’est différent de : être symptôme.
- le « symptomatologie ».
« Joyce ne s’adresse pas a un corps donné » : ni homme, ni femme. Dans l’équivoque, il y a : « corps donné » et « coordonnée ». Ce dernier terme implique une relation entre un élément et un autre. C’est-à-dire entre un 1 et un 2 : un corps avec un autre corps ou un corps avec le sien. C’est branché sur un corps qui a un 2. Joyce, lui, reste un corps 1, un corps hors-sens.
E. Laurent, indique que le texte même de Joyce est une énigme a déchiffrer mais qui n’intéresse pas au symptôme de l’autre, au 2. Joyce ne s’y intéresse pas. Il n’est pas articulé et donc il n’y a pas de prise par le sens. Il n’est pas articulé au symptôme de chacun.
Le texte de Joyce n’intéresse pas le lecteur à son propre symptôme, précise E. Laurent. En effet, quand on lit Joyce on ne ressent rien. On n’est pas affecté, il n’y a pas de 2, pas de sens, pas d’effet de sens, ni de ressenti. Donc, cela ne nous intéresse pas à notre symptôme. Cela signifie que ce qui nous passionne dans un texte, c’est ce qui nous intéresse à notre symptôme. Et, le symptôme c’est ce qui nous affecte. Pour que le corps soit affecté, il faut en passer par le 2, qui cogne sur le 1 de jouissance qui itère. Alors que pour Joyce, l’énigme du symptôme se déporte sur l’énigme du texte à déchiffrer. C’est à ce titre que Joyce n’est pas dans une position féminine puisque justement la position féminine, si on suit Lacan, c’est d’intéresser le corps du sujet à son symptôme. Il y a une tentative chez Joyce d’aller de ce côté-là mais « qui rate dans sa chute ». L’idée de s’accomplir en tant que symptôme est ratée dans sa chute.
Alexia Lefebvre-Hautot
Notes :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p. 172.
2 Ibid., p.173.
![]() Jeudi 9 novembre 23 novembre
Jeudi 9 novembre 23 novembre
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent, à partir de la page 175, Lacan post-joycien.
Ce 23 novembre, nous avons repris l’étude du livre d’E. Laurent à partir de la page 175, « Lacan post-joycien ».
Un premier questionnement nous a conduit à travailler autour de la formule « se faire la dupe du père ». En effet, Joyce, à travers ses écrits, se faisait « la dupe du père », s’en servant comme modèle, tout en s’en passant. Joyce n’est pas assujetti au nom-du-père. Il se fait lui-même un nom par le biais de son art. Il dit de son père : « Il ne m’a jamais parlé de mes livres, mais il ne pouvait me renier. L’humour d’Ulysse est le sien [...] Le livre est son portrait craché ». Ce qui fait dire à E. Laurent que : « Joyce a su se passer du père en se servant de celui-ci comme modèle pour son art ».
Nous avons pu noter qu’il en est de même pour J. Prévert, qui se faisait lui aussi la dupe du père. Nous avons repris en partie le texte de Dominique Laurent1 dont voici une citation : « la passion particulière dont Prévert a témoigné dans son œuvre poétique pour dénoncer l’imposture paternelle » et un peu plus loin : « Pour le poète […] la figure paternelle est marquée du sceau de la dérision la plus totale. » ou encore, « Il apparut à Jacques comme un père qui ne rimait à rien » et Prévert, lui, s’attacha à rimer à quelque chose.
C’est là la force d’un destin, passant de force à farce. Joyce fait une farce de la version œdipienne, passant par la version du père. Alors, il est « non dupe », en même temps qu’il se fait la dupe du père, à savoir qu’il en fait « le portrait craché », dans une certaine ironie, une certaine farce. Voilà que le drame pour certains devient farce. C’est aussi ce que l’on voit dans la fin d’analyse, où quelque chose de ce qui faisait tragédie, drame, devient comique. J. Prévert et Joyce se moquent de la force du destin et l’on trouve là « le choix forcé de la farce », renvoyant à la dimension de la mission et la répétition.
Un bref rappel de ce que note Lacan dans Le sinthome, concernant « la démission paternelle » a pu être évoqué. Lacan considère que le père de Joyce ne lui a rien transmis ayant pour résonance chez Joyce une mission, qui serait à la mesure de la démission paternelle. Il en va de même chez J. Prévert. Pour préciser un peu les choses, Joyce et J. Prévert se passent du nom-du-père et se servent de l’imposture paternelle, faisant de la démission paternelle – l’imposture – une mission, un sinthome. C’est peut-être une façon de ne pas être fou, de faire en sorte que ça ait l’air de tenir. Ainsi, dénoncer l’imposture c’est, d’une certaine manière s’en servir.
C’est différent pour Schreber, aux prises avec un père féroce, se prenant pour un père. Quand Schreber écrit ses mémoires, il écrit plutôt son délire, mais il n’est pas sûr qu’il se serve du père. Il en est plutôt la victime et essaye de répliquer, de faire face à ce qu’à été pour lui un père de la jouissance. On y voit bien les efforts de réplique mais sans en passer par la farce. Et, si Joyce lui-même fait un effort de réplique, c’est un effort de farce. Chez Schreber, il y un traitement des voies et d’un monde qui puisse tenir debout. Alors que Joyce n’est pas en rupture. Il est un écrivain reconnu. Chez Schreber, il s’agit plutôt d’une reconstruction à partir de décombres.
Nous sommes ensuite passés au chapitre suivant, « L’impossible portrait de l’artiste ». Nous avons échangé autour de ce questionnement de E. Laurent « Comment donner chair à ce qui, au-delà de l’image, est invisible, comment rendre visible un « mouvement de l’âme » ou les « formes de la subjectivité ? » Nous y avons lu que « le mouvement le plus intime de l’être », est ce que cherche à attraper Rembrandt.
Alexia Lefebvre-Hautot
Note :
1 Laurent D., « Lacan et Prévert », La Cause Freudienne n°79, pp. à 192 - 196.
![]() Jeudi 21 décembre
Jeudi 21 décembre
Nous poursuivrons le chapitre « L’impossible portrait de l’artiste » à la page 182, à partir du sous chapitre « Rothko : le corps de l’abstraction ».
![]() Jeudi 8 février
Jeudi 8 février
Nous poursuivrons le travail engagé.
Lors de cette séance de travail, nous avons terminé l’étude du chapitre « L’impossible portrait de l’artiste », abordant les deux sous-chapitres, « Rothko : le corps de l’abstraction » puis « Gehry : l’en-forme de l’objet ».
A cette occasion, il a été question d’aborder rapidement l’exposition qui se tient actuellement à la Fondation Vuitton, où les œuvres de Mark Rothko sont exposées. Dans le livre regroupant des textes et les œuvres de M. Rothko, Suzanne Pagé évoque la dimension d’un : « Comment dire ce qui ne peut l’être et pourtant s’éprouve intensément1 ? ». Elle ajoute que Rothko a voulu exprimer les émotions humaines fondamentales , par le biais de son art.
Pour son fils, Christopher Rotko, Mark Rothko cherchait à exprimer dans son art, le reflet de « l’expérience et la condition humaines, le drame humain2 ».
Mark Rothko disait de son art qu’il vit et respire certes, mais indiquait par ailleurs qu’ : « à ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j’aimerais dire que j’ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. » Phrase marquante s’il en est, qui ne laisse pas indifférent le spectateur allant à la rencontre des tableaux.
L’exposition montre des tableaux de plus en plus sombres et une répétition de trois bandes, structurées selon trois niveaux qui vont, au fil des années, se vider des personnages, et des objets.
Reprenant la lecture du livre, nous y avons repéré le rapport de Rothko et de Gehry au miroir, dans une dimension pré-spéculaire.
Dans ces deux sous-chapitres, E. Laurent développe avec beaucoup de finesse, comment s’opère dans les œuvres de ces deux artistes, une « extraction topologique [qui] transforme le vide en cet objet qui nous regarde, qui nous fascine, qui convoque notre regard. [Et où] l’objet est « articulé au corps par l’effet qu’il produit et qui n’est pas un effet de signification »3 ». Nous voyons là comment à la fois l’objet est extrait mais aussi localisé dans l’œuvre d’art. Il y a un effet de jouissance, quelque chose de hors-sens. Nous nous situons là du côté de l’éprouvé, de pré-spéculaire. Ce n’est pas pris dans les rets de la signification ou de la reconnaissance, puisqu’en effet, dans le stade du miroir, lorsqu’il y a reconnaissance, il y a déjà quelque chose en route du côté du symbolique. Dans le mouvement de l’analyse, par contre, on ne cesse pas d’extraire l’objet, ce qui est un peu à l’envers. On commence par donner des significations, donner du sens, jusqu’au moment où cela se matérialise dans un objet de jouissance, un objet petit a ; un vidage s’y opère.
Dans la dimension d’extraction topologique nous y voyons l’idée que ce qui est à l’extérieur, c’est le plus intime. La boîte de sardines qui nous regarde, c’est le plus intime de ce pêcheur qui passe son temps à aller pêcher des sardines pour l’industrie et qui voit la boîte de sardines qui le regarde et qui est comme le condensé de toute son activité, de tout le circuit et ça, ça nous regarde, ça nous revient de l’extérieur et ça nous regarde. Nous y reviendrons plus tard.
Les tableaux de Rothko, comme les œuvres de Gehry, sont articulés au corps par l’effet qu’ils produisent, hors signification. C’est la raison pour laquelle Rothko dit ne pas attendre que l’on soit fasciné par la couleur, qui reste un effet de signification et c’est aussi la raison pour laquelle il a ôté les titres à ses œuvres, donnant lieu à chacun d’y mettre du sien. Il ne s’agit pas de l’effet imaginaire de goûter la belle couleur mais d’un effet articulé au corps, lui faisant dire que des gens se mettent à pleurer devant ses tableaux, qu’il y a des événements de corps.
Rothko « peint le rien – comme un espace lumineux, sensuel, fluctuant, diffus et suffisamment grand et mobile pour entourer et envelopper le spectateur4. » Cela nous a évoqué le tableau signé, titré et daté 12.10.1970 de Zao Wou Ki(*), fascinant Lacan qui le réserva le soir même de sa présentation lors d’un vernissage. Il s’agit d’un tableau où la composition lumineuse de la palette, organisant un pourtour rocailleux, sorte de barrière de corail, autour d’un vide central, attirant le regard du spectateur.
Chez Rothko, l’on peut apercevoir à travers sa peinture quelque chose de sa mélancolie, du vide intérieur éprouvé. D’ailleurs lorsque nous regardons ses tableaux, il y a la dimension de faire corps avec le tableau.
E. Laurent parle d’un regard « meurtrier, froid », il y a un regard mauvais sur Rothko qu’il cherche, par son œuvre à traiter. Et il le traite, comme il l’indique dans la phrase citée plus haut, au « centimètre carré ». Nous y voyons là quelque chose de la pulsion de mort qui s’extrait et s’arrache dans ses œuvres. Dans le même temps, lorsque nous contemplons ses tableaux, nous y repérons une certaine épaisseur, une certaine douceur, où nous pouvons remarquer comme des fils de cotons. Ce n’est pas plat. Il y a des couches successives dans ses œuvres, où apparaissent des filaments. Pour autant, dans ses tableaux, nous sommes interpellés par la dimension du vide et, le repérage de ces couches successives, nous a questionné quant à la tentative de mettre un voile, une obturation sur le vide ? Il y a là une dimension de donner de l’épaisseur, de la substance, en rajoutant des couches sur des couches.
Cela nous a conduits à nous interroger sur ce qu’est l’effort, pour Rothko, de faire tenir l’image ? Au fur et à mesure qu’il avance dans son œuvre, il y a quelque chose qui se dissout, quelque chose du vide, au plus près du corps. Dans ses tableaux il tente de traiter quelque chose du corps, parce que l’image spéculaire ne tient pas. Ce qui interroge la question de l’éprouvé. Pour Rothko on n’est pas dans le système du spéculaire, de l’image du corps, mais on est dans quelque chose qui serait pré-spéculaire.
Concernant Frank Gehry, E. Laurent écrit que : « L’objet Gehry est à la fois forme organique et calcul constant ; il vit, il respire, calcule, pense, dans la mesure où sa « vie » est rendue transparente à tout moment grâce au calcul de tous les paramètres en jeu dans le fonctionnement : température, humidité, chiffrage des occupants, empreinte carbone5. » C’est donc une forme organique, vivante, près du corps. Là encore, il y a une corrélation entre l’œuvre et la problématique du sujet qui invente. L’euphorie « répond à l’angoisse et aux craintes de ruine et de perte de l’artiste6. »
Le psy de Gehry écrit dans une note qu’il y a dans le « style Gehry » une sorte « d’antidépresseur architectural ». Ainsi, par son art, Gehry se serait fabriqué son propre médicament, organisé de manière topologique, externalisant son vide intérieur – et ce, à travers ses œuvres. Nous y voyons là une inversion par rapport à Rothko qui lui, indique une sorte de précipitation dans le tableau, dans une sorte de one on one, revenant vers soi. Alors que par le biais de son système architectural, Gehry met en place une topologie, qui se pose en terme d’extériorité.
Il y a là un objet que l’on regarde et qui nous regarde, comme dans le souvenir de Lacan concernant la boîte de sardines, dans quelque chose de réflexif dont Freud parle à propos de la pulsion. On y voit une localisation, dans ce qu’il nomme « l’extraction topologique ». Là, l’objet a doit être extrait, dit Lacan, mais, dans la psychose il n’y a pas d’extraction de l’objet a, qui est dans la poche.
Même chez Rembrandt nous pouvons y trouver quelque chose de cet ordre-là, dans le rapport au corps, dans la mesure où il essaye de rendre compte, d’une dimension spéculaire dans ces autoportraits. C’est la prise du corps dans la surface, dans la toile.
Enfin, E. Laurent, nous précise cet axe précieux que les œuvres artistiques ont cet effet de subvertir « la relation que nous entretenons avec notre corps et celui de nos semblables7 . C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas là d’un espace géométrique habituel. Cela permet de borner un « lieu dans lequel éprouver le malaise que le lien à l’autre fomente et distille8 ».

- (*) Zao Wou Ki 12.10.1970
Alexia Lefebvre-Hautot
Note :
1 Pagé Suzanne, Livre de l’exposition de Mark Rothko, à la Fondation Louis Vuitton, p.19-24.
2 Rothko Christopher, op.cit., p.29-41.
3 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p.188.
4 Ibid., p.183.
5 Ibid., p.187.
6 Ibid., p.188.
7 Ibid., p.189.
8 Ibid., p.189
![]() Jeudi 21 mars
Jeudi 21 mars
Nous poursuivrons notre lecture, à partir du chapitre « Clinique et pragmatique du corps parlant », à partir de la page 191
Nous reprenons la lecture page 191 au chapitre « Clinique et pragmatique du corps parlant1 », ainsi nous revenons dans la clinique et d’emblée Éric Laurent nous propose de nous laisser guider par la conférence de Jacques-Alain Miller : « L’inconscient et le corps parlant 2 » publiée en 2016. Il s’agit d’une comparaison entre analyser l’inconscient au sens de Freud (structuré comme un langage) et analyser le parlêtre. Mais comment le dire ? Ainsi aux analystes il pose : « faisons-nous, cette pratique analytique de l’analyse du parlêtre « sans le savoir » pouvons-nous en témoigner ? » Partant de l’opposition entre symptôme formation de l’inconscient, structuré comme un langage, métaphore, effet de sens induit par la substitution d’un signifiant à un autre et sinthome ; un premier questionnement émerge à la lecture de la première page est-ce que le sinthome est seulement évènement de corps et émergence de jouissance ? Nous nous interrogeons sur la réponse à cette question... Il est évoqué une présentation de Guy Poblome sur le symptôme dans un cas présentant un symptôme d’une éjaculation précoce (symptôme / sinthome) et d’une conversation qu’il avait pu avoir avec Laurent Dupont pour répondre à cette question, examiner le cas sous les deux angles.
Nous continuons à partager nos réflexions en avançant dans le texte.
Nous repérons dans le cadre du symptôme les conséquences cliniques en ce qui concerne : le transfert, l’interprétation, le contrôle et la passe. Le texte d’Eric Laurent commence par traiter la question du contrôle en référence à la première leçon du séminaire XXIII « De l’usage logique du sinthome3 ».
Nous plongeons dans la partie : le symptôme et la supervision :
Cette partie fait d’abord référence au « Discours de Rome4 » où il est démontré la domination du symbolique sur l’imaginaire, la notion de filtre constitué par l’analyste qui recueille les mots du patient pour les rapporter. Concernant le contrôle, l’ensemble de la communauté analytique reconnaît que cela témoigne de quelque chose de l’expérience qui se transporte malgré tout ce qui résiste au dire ; précisons ce qui résiste : la présence, la posture, l’habitus, et le réel de l’ineffable de la rencontre. Sur cette domination du symbolique sur l’imaginaire le contrôle d’une analyse par un analyste est souligné comme étant : un des modes les plus clairs et les plus féconds de la relation analytique. Examinons cette formule et les quatre points qui semblent faire obstacle donc pas question de s’intéresser de façon préférentielle à la présence à la posture au réel de la rencontre il s’agit de redonner la parole recueillie mais en se dégageant de l’idée que l’analyste aurait « un don clinique supposé impénétrable ».
L’analyste débutant doit se faire « plaque sensible » référence prise à Lacan dans le Séminaire XXV l’acte psychanalytique, cours du 29-11-1967 et repris par J.-A. Miller dans une conférence donnée à Grenade en 1990, l’école et son psychanalyste5 chapitre passeurs : entre dans le dispositif en tant qu’ignorant, témoigner à partir de celui qui a fini, d’un pas en avant pour lui-même, mais capable d’apercevoir un pas en arrière). (qualifie le mode d’innocence du passeur qui se fait plaque sensible).
Examinons cette idée de plaque sensible reprise par J.-A. Miller, de récepteur qui s’imprime de coloration plus ou moins nuancée qui se reflète à partir de l’écoute de l’analyste. J.-A. Miller précisera qu’il faut se dégager du côté don impénétrable et talent du jeune analyste mais il s’agit plutôt de s’affronter avec le réel. Le contrôleur manifeste lui une seconde vue qui rend pour lui l’expérience aussi instructive que pour le contrôlé. La conversation se porte sur l’intérêt de chaque psychanalyste dans cette position de contrôleur qui a apporté et reçu beaucoup dans son expérience pratique, l’insistance est portée sur la qualité de s’effacer du jeune analyste qui est d’autant plus accessible et qui retransmet plus justement.
Puis E. Laurent aborde la question de la transformation de la direction de la cure à partir de la question du parlêtre fin de la page 193. Il s’agit à partir de ce moment de structurer autrement l’expérience et de s’appuyer sur l’indication reprise par J.-A. Miller en 2002 sur la journée de travail sur le contrôle :
« L’analyste apporte au contrôle sa division ses palpitations alors que dans l’acte on est supposé s’en abstraire c’est aussi bien ce qui relativise la formule la subjectivation seconde du contrôle. Si dans le premier temps l’enseignement de la fonction porte sur l’analyste comme sujet, il en est d’une autre approche dans l’analyse du parlêtre ou l’analyste est en position d’objet petit a , le contrôle consiste à une re-subjectivation de l’analyste qui vient là comme sujet barré témoigner de son manque-à-être ,« mais si aujourd’hui on ne part pas seulement de l’objet a » et si « l’on part du parlêtre, la lumineuse évidence de contrôle est de la mise en valeur de subjectivité seconde comme objectif à atteindre ne s’opacifie-t-elle pas quelque peu ? »
Le contrôlé serait un filtre, réfracteur du discours stéréographie image dégageant les 3 dimensions (saisir mots, notes, sonorité, lettres). Les passeurs qui ont pu entendre se sont fait plaque sensible à leur tour pour l’AE ce qui fut l’occasion d’échanges autour de la perception de Marie Claude Sureau, lors de sa passe. Nous discutons autour de la fonction du passeur et de ce qui “ne passe pas”, évoquant ce que c’est que d’être encombré par son moi.
Sylvie Vitrouil témoigne d’une parole de Rosine Lefort en contrôle, « laissez votre moi à la patère ! » Il est question de se délester, d’abandonner quelque chose pour écouter notamment cette dimension d’un moi fort. Le contrôleur fait bouger, permet le déplacement de la position du contrôlé, à l’époque du parlêtre ce nouveau contrôle se fait à partir de la position en place d’objet a sur le discours analytique en haut à gauche, cette place qui est une place (tournant pour changer de discours) relance le processus du discours analytique.
Revenons sur la formulation c’est « l’effet dans le corps du fait qu’il y ait un dire6 » et que seule l’équivoque peut libérer du symptôme passer de la raison r.a.i.s.o.n, soit raisonnement logique, explication, interprétation même ; pour se détourner du sens avers le Réson R.é.s.o.n. Réson qui convoque la résonance7, est de l’ordre d’une sonorité et d’une équivoque sur lalangue. Cette percussion dans le corps d’un signifiant qui laisse sa marque sous la forme de la modalité d’un symptôme et d’une répétition de jouissance. Sa compacité peut se voir fractionnée par la coupure, par la production d’une équivoque, donne une autre résonance à ce qui consonne autrement dont l’effet se fait sentir dans l’après coup d’une séance. Par une chute de ce qui semblait tenir de façon plutôt figée et ordonner : la jouissance du sujet.
Nous rappelons l’invitation de Laurent Dupont et sa conférence attendue le 2 avril à Vernon8 sur : « L’interprétation - Raisonnement et Résonance » et l’occasion pour nous de lui poser les questions pour éclairer la question de l’équivoque sur lalangue comme équivoque dont les effets ne sont pas connus à l’avance.
Dans ces actes de coupure qui libèrent du symptôme, les effets d’équivoque qui opèrent. Nous avons échangé sur cette expression qui « libère du symptôme » ; du symptôme s’agissait-il d’en produire ou de s’en libérer ? il semble qu’à priori il s’agit bien de s’en libérer, de se défaire de se délester et que c’est la fonction spécifique de cette coupure que d’occasionner cette perte ou tout au moins cette effraction qui pourrait libérer, faire effraction, qui casse, permet d’extraire des éclats de ce symptôme qui semblait d’une solidité inattaquable.
Martine Desmares
Notes
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p.191.
2 Miller : J.A. « L’inconscient et le corps parlant », Présentation du congrès AMP Rio 2016, Scilicet, Le corps parlant Sur l’inconscient au XXIe siècle, Collection rue Huysmans ; ou La cause du désir n°88, L’expérience des addicts, p 103-114
3 Lacan J., Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Seuil, Paris, p.17
4 Lacan J., « Discours de Rome » prononcé le 26 septembre 1953 pour introduire le rapport « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Autres écrits, Paris, Seuil, Col. Champ freudien
5 Miller J.A., « L’école et son psychanalyste », Quarto n°110, La formation sur mesure du psychanalyste, p. 17
6 Lacan J., Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Seuil, Paris, p.17
7 ibid.
8 Dupont L.., L’interprétation Raisonnement et Résonance, « l’interprétation est un au-delà »
![]() Jeudi 18 avril
Jeudi 18 avril
Nous reprendrons à la page 196, au sous-chapitre « Le sinthome madaquin et le sinthome roule ».
Nous avons repris à partir de la page 196, et avons abordé la dimension du sinthome madaquin et du sinthome roule et avons essayé d’élaborer rapidement un tableau les représentant chacun :
![]() Sinthome madaquin
Sinthome madaquin
Il relève de la jouissance de l’S.K.beau.
Il est situé du côté du sens.
Il est élevé au semblant.
![]() Sinthome roule
Sinthome roule
C’est le symptôme du parlêtre, qui implique le corps.
Le symptôme surgit dans la marque que creuse la parole quand elle prend la tournure du dire, incluant celui qui parle, et ce qui fait événement dans le corps.
Il se détache du NdP et du S1 pour rouler seul.
Contrairement au sinthome madaquin, situé du côté du signifiant-maître et du du régime de la langue liée au NdP, le sinthome roule se sert lui du S1, détaché de tout régime soumis au NdP.
Lacan, dans son enseignement, va passer de l’interprétation du désir à la place de semblant d’objet a. De fait, une interprétation guidée par le désir, tombe inéluctablement sur la question du sens, d’où la formule de Lacan : « Le désir, c’est son interprétation », indiquant que quelque chose échappe, fuit entre les articulations signifiantes. Pour que l’objet a puisse être dégagé, il faut que la fuite s’arrête. C’est pourquoi il est fondamental de ne pas s’orienter par rapport à l’interprétation, uniquement sur la question du désir.
Le texte de E. Laurent met en avant le fait que les effets d’une interprétation sont incalculables. On est d’ailleurs surpris des effets de l’interprétation lorsque celle-ci est réussie. Il s’agit d’effets inattendus, ne pouvant être anticipés, contrairement à ce que revendiquent les TCC.
Lorsque E. Laurent indique que « l’interprétation vise le corps parlant », cela revient à énoncer qu’elle ne vise pas le sujet du désir.
« Pour y produire un événement, pour passer dans les tripes » : il est nécessaire que ça ait un effet de corps, qu’il y ait un éprouvé, quelque chose d’hétérogène à l’habituel et lié au corps parlant de telle sorte que ça lui fait écho.
Concernant la question du transfert, nous pouvons nous reporter au livre de Jacques-Alain Miller, Comment finissent les analyses, Paradoxes de la passe1, au chapitre « Vue de la sortie », où Jacques-Alain Miller indique que pour qu’il y ait transfert, il faut que l’analyste rentre dans le monde du futur analysant, qu’il trouve une place et vienne s’y loger comme objet, dans le circuit libidinal de l’être parlant.
La parole est située du côté de ce qui peut résonner dans le corps du parlêtre s’adressant à l’analyste. Et, pour que cette parole résonne dans le corps, produise un effet, touche la jouissance en jeu, il faut que l’analyste soit au plus près d’incarner l’objet a pour l’analysant. Pour que l’analyste puisse s’introduire comme objet a, il faut que la jouissance circule. L’analyste devient alors lui-même un semblant d’objet pulsionnel. Notons que lorsque nous incarnons l’objet a, il n’est pas nécessaire de beaucoup parler.
A quel moment parler ? A quel moment se taire ? Nous avons à faire malgré tout à la question du diagnostic, afin de ne pas faire « flamber » quelqu’un par exemple, et ce, dans la mesure où il y a des silences qui peuvent être ravageant pour le parlêtre.
Il ne s’agit donc pas de n’importe quelle parole, (du côté du sens), ni de n’importe quel silence. Cela s’entend ici du côté de l’orientation psychanalytique lacanienne qui se situe du côté de l’usage de la parole et du silence. Certes, l’analyste se tait mais il y a quelque chose de la présence, par l’incarnation de l’objet a, a contrario du silence « imbécile ». Et des fois, l’incarnation tient à une mimique, à un geste. L’incarnation de l’objet a, est quelque chose qui résonne, fait résonner et entre dans le circuit libidinal de l’analysant.
Ainsi, à partir d’une nouvelle appréhension du symptôme nous avons un nouvel usage de l’interprétation et la notion de réduire, pour l’analyste, sa présence, ne peut s’entendre qu’à la condition d’y ajouter : réduire sa présence à l’incarnation de l’objet a, parce que c’est de cette place que l’on s’adresse à la jouissance du corps parlant.
Poursuivant notre lecture, nous avons pu aborder la question des A.E., et constater qu’il est intéressant d’entendre les témoignages de passe à partir de cette question des effets de l’interprétation de l’analyste sur la jouissance de l’A.E. Il est plus intéressant de se demander ce que l’on entend, plutôt que d’être fasciné par la démonstration de ce qui a fait évolution, S.K.beau, ce qui rend aimable et fait vibrer à l’écoute d’un témoignage de passe. Nous ne pouvons pas faire sans, mais, au-delà de ça, il nous faut repérer comment cela s’est joué, comment il y a eu incarnation de l’objet a par l’analyste ?
E. Laurent a ensuite abordé rapidement « Le symptôme au second degré », c’est le symptôme hystérique où il s’agit de se faire symptôme du symptôme de l’Autre.
Puis, il a été question d’aborder la dimension du type clinique de la névrose obsessionnelle, à partir de ces questions : « Comment étendre cet abord nouveau […] notamment [… à] la névrose obsessionnelle, quand le symptôme central affecte la pensée et non le corps ? Comment penser le symptôme obsessionnel dans la perspective du parlêtre, puisqu’il s’agit pour ce symptôme d’un encombrement de la pensée ? Comment reprendre alors le symptôme à partir de l’événement de corps2 ? »
Il y a, chez le sujet obsessionnel nous dit E. Laurent une alliance entre le regard et la gonfle. Cela se situe donc du côté de la forme du corps au sens où le parlêtre obsessionnel à un certain rapport à son corps, qui concerne la forme de celui-ci, la place qu’il occupe libidinalement, narcissiquement. Il est donc important de voir comment le lien entre gonfle et regard vient encombrer ce sujet obsessionnel. Sujet pour qui le regard est surtout du côté de l’A(a)utre sujet prisonnier dans la fenêtre du fantasme entre le regard et la gonfle.
Poursuivant le texte, nous avons pu noter qu’il y a une oscillation entre la question de la vérité et celle se situant du côté de la jouissance. Si on porte attention sur la jouissance, nous sommes attentifs à la façon dont cela se présente et ce que peut en dire l’analysant, dans sa façon de faire consister un symptôme de son mal-être.
L’analysant va mettre du sens ou essayer d’en mettre, tourner autour.
L’analyste, lui va s’abstenir de le faire.
Et, pendant que l’analysant se préoccupe de ça, l’analyste lui, peut s’intéresser à la jouissance que cela fait apparaître. Ensuite, il s’agit de faire émerger, quelque chose qui se décale du sens et qui est attrapé à partir du dire de l’analysant, de son énonciation.
Alexia Lefebvre-Hautot
Notes :
1 Miller Jacques-Alain, Comment finissent les analyses Paradoxes de la passe, Navarin éditeur, 2022, p.71-78.
2 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p.199.
![]() Jeudi 20 juin
Jeudi 20 juin
Il est proposé de revenir sur la dimension regard/gonfle, sac/bulle, du côté de la névrose obsessionnelle.
Par ailleurs, nous poursuivrons notre lecture à partir de la page 200, « Le regard et le corps : de l’obsession à la psychose »
Studiolo
Les jeudis 28 septembre, 9 novembre 23 novembre, 21 décembre 2023, 8 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin 2024 à 21h en visioconférence ZOOM
Un lien Zoom est adressé aux participants avant chaque séance.
Ce groupe est ouvert à de nouveaux inscrits.
Participation aux frais : 5 € par soirée ou 25 € pour l’année et pour l’ensemble des activités et séminaires proposés par l’ACF-Normandie. Réduction de 50 % pour les étudiants.
Responsable et contact : Alexia Lefebvre Hautot
Pour contacter la responsable : envoyer un mail
Revenir à L’ACF-Normandie » ou à l’Accueil du site ».
Accéder à l’Agenda ».