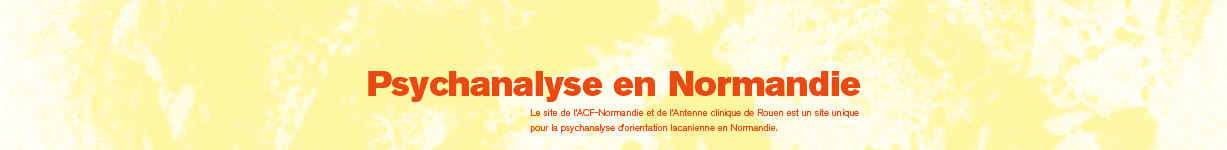ACF-NORMANDIE

- Présentation de l’ACF
-
Séminaires de l’ACF et activités des membres
- - ACF 2022-23 : les archives.
- - ACF 2021-22 : les archives.
- - ACF 2020-21 : les archives.
- - ACF 2019-20 : les archives
- - ACF 2018-19 : les archives
- - ACF 2017-18 : les archives
- - ACF 2016-17 : les archives
- - ACF 2015-16 : les archives
- - ACF 2014-15 : les archives
- - ACF 2013-14 : les archives
- - ACF 2012-13 : les archives
- - ACF 2011-12 : les archives
- - ACF 2010-11 : les archives
- Cartels de l’ECF
Recherche
Par activités
- Activités ROUEN
- Activités LE HAVRE
- Activités EURE
- Activités CAEN
- Activités CHERBOURG
- Rouen archives
- Le Havre archives
- Eure archives
- Caen archives
- Cherbourg archives
- À ÉCOUTER
- AUTISME
Publié le jeudi 28 septembre 2023
Séminaire Janus « Lacan pour tous » – 2023-24
Alpha plus Bêta, un lieu pour parler de la théorie : « L’incongru qui interprète ou pas. Quelle interprétation dans les pratiques de parole ? »
Les mercredis 22 novembre, 20 décembre 2023, 24 janvier, 27 mars, 17 avril, 29 mai 2024 -20h30 - Visioconférence
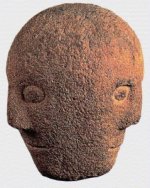
Le Séminaire Janus comporte Alpha plus Bêta : un lieu pour parler de la théorie et Schmilblick, un lieu pour parler des pratiques. Alpha plus Bêta et Schmilblick ne sont pas symétriques l’un de l’autre...
La théorie psychanalytique ne constitue pas un ensemble fermé, un tout dogmatique, mais au contraire un ensemble ouvert (sans totalité), toujours remanié par l’opacité ou le réel qui aimante la pratique. L’enseignement de Lacan est radical parce qu’il met la faille entre théorie et pratique1 au cœur de l’élaboration de l’expérience analytique – cette faille traverse la théorie elle-même, qu’on la nomme sujet, manque, trou, objet a, jouissance etc. Au fond cette faille est liée à l’incidence du langage en tant que tel, elle est liée à l’impact du signifiant sur les corps parlants et les développements logiques qui en sont la conséquence.
Voilà le point de départ de la pratique et de la théorie psychanalytiques. Parler de logique signifiante vient déplacer la question des rapports entre théorie et pratique ; elle nous met sur la piste de la lecture et de l’écriture. Qu’est-ce qui se lit dans une pratique ? Qu’est-ce qui peut s’en écrire ? Quels sont les liens entre la lecture et l’écriture ? Entre l’opacité et le sens ? C’est à partir de la parole et du signifiant qu’une pratique qui a pour boussole la psychanalyse peut opérer, avec l’éthique du bien-dire, même si le praticien s’oriente, lui, à partir de ce qui résiste au sens, de ce qui fait opacité.
Nous vous proposons de venir parler de théorie à partir de ce point de départ. Pour cela, chaque soirée sera animée par un binôme. L’un aura écrit le texte d’un cas ou d’une situation issue de sa pratique, l’autre l’aura lu et de sa lecture découlera un premier travail en commun ; ils nous en livreront le résultat qui mettra en exergue les concepts permettant une lecture du cas ; ceci rendra possible une conversation autour de toutes ces élucubrations.
Alpha plus Bêta s’adresse à tous ceux qui sont taraudés par leur pratique et la tentative de l’éclairer, d’en rendre compte, et plus particulièrement aux jeunes praticiens, et aux moins jeunes ! Alpha plus Bêta s’adresse aussi aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement de Lacan, et se demandent comment… le lire !
Le Séminaire Janus comporte, outre Alpha plus Bêta, Schmilblick , un lieu pour parler des pratiques, qui n’a pas lieu le même jour. Schmilblick n’est pas symétrique d’Alpha plus Bêta ; tous ceux qui participent à Schmilblick sont invités à venir à Alpha plus Bêta, l’inverse n’est pas proscrit mais n’est pas prescrit non plus ! A chacun de faire selon son goût !
Marie-Hélène Doguet-Dziomba
Note :
1 Notre époque psy, celle du DSM, se veut « athéorique », aspirant à dissoudre le champ de la clinique dans des listes syndromiques sous la férule des « preuves scientifiques » souvent assimilées à des chiffres voire des algorithmes. Ces listes « athéoriques » sont d’une autre nature que ce que Lacan appelait « l’enveloppe formelle du symptôme », elles sont déconnectées du réel de chaque patient, et méconnaissent la logique signifiante qui donne son armature structurale à chaque cas. Elles laissent de côté le rapport complexe entre théorie et pratique. Car une pratique est toujours sous-tendue par une théorie qui n’a pas besoin d’être éclairée pour avoir des effets ; et une pratique s’inscrit toujours dans un discours qui lui donne son cadre ; quant à la théorie d’une pratique, elle suppose toujours un certain usage du concept, un « mésusage » selon Lacan, si l’on considère que jamais un concept n’abolira le réel en jeu dans la pratique.
Nous allons poursuivre le Séminaire en gardant notre formule : un texte présenté par un praticien d’orientation lacanienne, travaillé en amont et en binôme avec un « lecteur », pour en extraire une première étude nouant théorie et pratique, centrée sur ce qu’il s’est passé d’effectif lors des rencontres avec le patient. Ce texte sera adressé aux participants avant la séance afin de favoriser la conversation lors de celle-ci.
La thématique retenue comme fil rouge pour cette année sera une interrogation sur l’interprétation, objet des prochaines J53 de l’ECF. Nous pourrons nous appuyer sur le texte de Jacques-Alain Miller, datant de 1996, « L’interprétation à l’envers1 ». Dans ce texte, Jacques-Alain Miller souligne l’impasse « d’unilatéraliser l’interprétation du côté de l’analyste, comme son intervention, son action, son acte, son dit, son dire », alors que l’interprétation est incluse dans le concept même d’inconscient : l’inconscient est interprétation et il veut être interprété, à l’instar du désir inconscient du rêve qui est « désir de prendre sens ».
J.-A. Miller pose la question, dans ce texte, de ce que serait une « interprétation » dans une pratique qui vise dans le sujet le symptôme, non conçu comme un message refoulé à déchiffrer, mais comme un « phénomène élémentaire » révélant « une opacité irréductible dans la relation du sujet à lalangue », autrement dit dans ce qu’aura été pour le sujet la rencontre de jouissance avec les signifiants primordiaux S1, avant que ceux-ci n’aient pris forme d’inconscient, c’est-à-dire d’une articulation S1-S2 qui leur donne sens. J.-A. Miller nomme cette « interprétation » visant la jouissance du symptôme, l’interprétation « à l’envers » (de l’inconscient, si nous concevons l’inconscient à partir de l’articulation langagière S1-S2).
Dans la pratique d’orientation lacanienne, nous pouvons appréhender « l’opacité » du symptôme à partir du surgissement de « l’incongru » dans les pensées, dans le corps ou dans les conduites du patient tel qu’il en fait part au praticien ou tel qu’il en fait monstration – quelles formes prend cet incongru, comment est-il rejeté ou dénié, comment le praticien l’accueille-t-il, et en quoi cet incongru est-il ou pas une interprétation pour le patient ? Comment cet incongru prend-t-il sens ou pas ? Peut-être même que c’est la façon dont le praticien accueillera cet incongru qui le rendra incongru pour le patient ? En tout cas c’est à partir du traitement de l’incongru que nous tenterons de cerner ce qu’il en est du symptôme dans chacun des sujets et comment l’action ou le dire du praticien aura permis d’introduire du nouveau dans la position du sujet. Toutes ces questions permettent en effet de dégager une orientation dans la direction des rencontres que nous vous proposons d’explorer cette année.
Marie-Hélène Doguet-Dziomba, responsable du Séminaire
Note :
1 J.-A. Miller, « L’interprétation à l’envers », 7 Mars 2021, Nouvelle Série L’Hebdo-Blog 230
![]() Mercredi 22 novembre :
Mercredi 22 novembre :
Séance animée par Marie-Hélène Doguet-Dziomba et Catherine Grosbois
Le texte de Catherine Grosbois nous permet de poser quelques jalons sur le thème de l’interprétation. Tout d’abord Catherine nous montre avec précision comment elle a accueilli Lily accompagnée de sa « tata » (famille d’accueil) ; d’emblée c’est au « sujet » dans Lily qu’elle s’adresse pour lui faire signe ; elle gronde la scie qui fait « des bêtises », marquant un écart entre Lily et le signifiant « bêtise » dont Lily s’empare pour dire « j’ai fait des bêtises », elle isole le signifiant « biberon » que Lily a jeté, ce qui amène au premier plan le placement (pour « carence » et « maltraitance ») et la mère éloignée, « elle est loin maman ? » dit Lily en même temps qu’elle laisse tomber des roues ; ses énoncés ne valent pas tant pour leur suite qu’en tant qu’ils se déposent dans un lieu vidé du sens commun où peut se brancher le circuit de la parole « sous transfert ».
Comme l’écrit Catherine, Lily se montre ainsi capable « de faire quelque chose de ce qui lui est dit, et surtout de prendre en compte nos réponses à ce qu’elle dit elle-même, que nous tentons d’écouter pour faire signe au sujet qui s’y manifeste. » Cet « entretien préliminaire » marque l’entrée de Lily à l’Hôpital de Jour. Catherine ajoute : « Mais elle parle rarement, et surtout pour dire que non. Son corps ne semble pas lui appartenir et parfois elle le maltraite se donnant des claques, ou maladroite, elle se cogne. »
Le deuxième temps interprétatif peut être qualifié d’une lecture rétroactive que Catherine fait d’une séquence à l’HDJ et de ses suites (jusqu’alors non sues) : après une séquence complexe dans la pataugeoire avec des transvasements, des bacs de tailles différentes, la présence dans l’eau d’une soignante, Lily loge brièvement son corps dans le bac, avec satisfaction. Il s’ensuivra, dans sa famille d’accueil, une encoprésie et un étalement sur les murs de ce qui est sorti de son corps (la « bêtise »). La lecture de Catherine est la suivante : un débordement de jouissance sous la forme d’un « trop de plaisir ou d’un trop de peine » crée les conditions du symptôme (ici l’encoprésie et l’étalement sur le mur). Ce point est crucial dans l’orientation qu’il éclaire ; ici ce n’est plus seulement le « sujet » dans Lily qui est convoqué, c’est Lily comme « parlêtre » qu’il s’agit de soutenir : le « parlêtre » Lily inclut la jouissance du symptôme et le « dire » qui s’en extrait…possiblement.
Ce que démontre le troisième temps de l’interprétation, cette fois du côté de Lily. Une fois le symptôme situé, ce sont les temps élargis avec le père et le retour concret de la mère qui viennent au premier plan. Lily s’autorise à parler d’un « cauchemar » à répétition dans lequel une mère frappe et jette son bébé dans l’escalier. Puis elle fera part de conduites abusives de son père et de son refus de voir sa mère en photo et en vrai. Elle livre à Catherine son interprétation : je n’ai ni papa ni maman, tonton et tata « ça suffit ».
Il est intéressant de souligner un quatrième temps en forme d’épilogue, alors que Lily quitte l’HDJ. Catherine, dans l’après-coup de l’interprétation de Lily, mène une enquête rétrospective sur les conditions initiales du placement. Elle y découvre les signes somatiques de la maltraitance dont Lily a été l’objet et l’hypocondrie délirante du père dans laquelle elle a été incluse (laxatifs etc.). L’équipe était dans l’ignorance de ces faits, mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel est qu’un dire de Lily ait pu advenir – grâce à la lecture attentive par Catherine et l’équipe de l’HDJ du symptôme de Lily tel que le transfert a permis de le constituer comme tel.
Marie-Hélène Doguet-Dziomba
![]() Mercredi 20 décembre :
Mercredi 20 décembre :
Séance animée par Cyril Duhamel et Catherine Grosbois
Quand le sujet de l’énoncé d’un patient disparait dans son récit, comment le faire surgir par une intervention ce qui sous-tend ce qui est dit ? Intervention qui pourrait alors engager le transfert ?
Cyril Duhamel nous montre sa patience à attendre le moment propice pour intervenir.
Cette mention souligne que le silence de l’analyste n’en fait pas un « yes man », ni une adresse à « la cantonade » , mais que l’attention se porte sur le sujet de l’énoncé.
Cela va permettre que soit développé une anamnèse qui ne s’était pas imposée jusqu’alors.
Cyril devait être « conforme », ou « normal » à « un psychanalyste » comme dans les livres, donc silencieux ; l’intervention fait surgir un interlocuteur qui questionne, qui se fait partenaire. Et ouvre sur une certaine appréhension de la division subjective, malgré l’effort de « maîtrise » annoncé au début du travail.
Je dirais aussi que le style de ce patient est plutôt d’effacer le sujet de l’énonciation, entre énigme et citations.
C’est ce que l’intervention touche de la bonne façon ; il n’est plus seul avec la parole non coupée ; Cyril se manifeste de telle sorte que Mr I. perçoit qu’il ne monologue pas ; mais il est déjà engagé dans « ce qu’il aime » : le débat.
C’est ce que je propose à notre débat, à partir de ce texte précis sur un début de cure.
Nous pourrons également questionner les suites de l’intervention, et en particulier le changement de l’humeur de Mr I.
Catherine Grosbois
![]() Mercredi 24 janvier :
Mercredi 24 janvier :
Séance animée par Marie-Hélène Acher et Marie-Hélène Doguet-Dziomba
Marie-Hélène Acher nous présente un traitement court, six rencontres avec Ambre, une petite fille de 10 ans qui souffre depuis 3 ans d’angoisse : elle ne peut dormir ailleurs que chez elle, elle a peur que ses parents ne meurent…à cause d’elle. La parole sous transfert d’Ambre va pouvoir se déployer et s’enrouler autour de ce qui a fait sa terreur : que l’Autre disparaisse, la laisse exclue, chutant de sa position d’objet aimé et aimable. A ce point d’horreur, où surgit l’angoisse, Ambre répond par son interprétation qui devient lisible à partir de différentes formations de l’inconscient : lapsus, actes manqués voire acting out. Par lesquels elle convoque l’angoisse maternelle qui finit par s’avouer, et tout un petit monde autour d’elle – les filles qui l’humilient, les garçons qui la conseillent, la mère à qui elle adresse une demande d’amour insatisfaite, le frère que la mère préfère, le père qui joue avec elle, la tempête qui gronde et la maitresse qui l’accompagne etc. Ce labyrinthe qui constitue un symptôme sous transfert semble tourner autour d’un point de vertige formulable ainsi : une fille disparaît, et dés lors que suis-je comme objet innommable dans le désir de l’Autre ? puis-je manquer à l’Autre ? que suis-je lorsque je suis exclue du circuit du désir de l’Autre ? un simple corps ?
Nous verrons quels bénéfices tire Ambre de ses rencontres avec Marie-Hélène Acher et sur quoi elle tire sa révérence.
Marie-Hélène Doguet-Dziomba
![]() Mercredi 27 mars :
Mercredi 27 mars :
Séance animée par Alexia Lefebvre Hautot et Marie Izard
Madame D. est adressée par son médecin généraliste pour grave dépression. Elle refuse le traitement prescrit par un psychiatre, les explications quant à son refus font d’emblée surgir une pluralité d’objets, indices du réel auquel elle a affaire ; elle note par ailleurs que cet homme ne l’écoutait pas et elle choisit de s’adresser à Alexia Lefebvre Hautot.
Madame D. ne déploie pas de roman familial comme en témoigne le texte même. Celui-ci s’articule à partir de quatre événements majeurs interprétés par la patiente comme étant la cause directe de son malheur et surtout des maux touchant au corps.
On pourrait à l’instar de la patiente dire : Action c’est à dire événement et Réaction, impact dans le corps.
« Corps et bouche ont été mis à rude épreuve » dit -elle, mais encore « tout ça a pris cher » en montrant sa bouche, sa gorge et son nez.
Tout ce qui lui arrive est interprété à l’aune de ces événements.
Objet sans valeur, identifiée à une pièce donnée par un agresseur et jetée à la demande de sa mère dans une rue pleine d’ordures , elle est logée à la place de l’objet déchet : capable de rien, ne servant à rien, nulle, conne… Précisons que le décès d’une amie-confidente l’éjecte radicalement de sa place dans le monde.
Nous nous attacherons à préciser l’interprétation que fait Madame D des événements en question mais aussi aux interventions d’ Alexia qui tendent à creuser dans le sens, « à faire des trous » dans le sens. Précisons qu’Alexia ne s’attarde pas sur le diagnostic de « grave dépression », elle choisit de permettre un certain ordonnancement, et de soutenir la dimension du vivant chez Madame D.
Marie Izard
![]() Mercredi 17 avril :
Mercredi 17 avril :
Séance animée par Serge Dziomba avec Nathalie Herbulot et Marie-Hélène Pottier
Une situation figée prenant l’allure d’un « arrêt sur image », ses protagonistes et son interprétation adressée
Ce qui apparait comme énigme
Un enfant de neuf ans refuse d’aller à l’école ou plutôt fait de l’école un obstacle insupportable, l’empêchant de rester auprès de sa mère. Que se passe-t-il ?
Les enseignants s’inquiètent et s’interrogent. Fait-il exprès, est-ce du registre du caprice ? Est-ce autre chose ?
La mère ne sait plus que faire, réagit au gré de ce qui l’assaille, de ce à quoi cette situation la confronte. La situation se pétrifie.
Nathalie Herbulot, psychologue de l’éducation nationale, orientée par la psychanalyse, est alors amenée à intervenir. Elle proposera l’adresse de Geppetto, ce qui sera accepté.
L’enjeu : Traiter par la parole l’horizon bouché
Savoir ce qui se passe pour Dan, comment en est-il arrivé à cet insupportable, ce trop qui fait souffrir, sera un véritable horizon pour aller au-delà de ses manifestations. Sur cette route sera traitée - de fait - la question de savoir si la « séparation » d’avec sa mère est impossible ou si ce qui se passe pour Dan ne renvoie pas plutôt à la contingence de ce qu’il a rencontré, qui se répète encore, pour venir se manifester à l’école.
Nous verrons les interventions de Nathalie Herbulot et celle de l’équipe de Geppetto provoquer un certain desserrage.
Serge Dziomba, lecteur.
![]() Mercredi 29 mai :
Mercredi 29 mai :
Séance animée par Céline Guédin et Serge Dziomba
Les pratiques d’équipes dans le champ médico-social sont basées sur la parole pour faire exister un collectif qui puisse s’interroger sur l’énigme qui se présente lorsque quelqu’un, un être parlant, est conduit à s’y adresser.
L’accueil comporte et implique cette énigme où les savoirs constitués trébuchent et vacillent. Il s’agit toujours a minima de neutraliser les a prioris et autres préjugés pour pouvoir accueillir ce qui déplait, ce qui fait peur, ce qui fait horreur. C’est à ce prix seulement qu’alors les professionnels peuvent inventer une pratique qui ait quelques chances de trouver son efficace.
Ceci est bien entendu valable pour le praticien lorsqu’il se retrouve seul avec la personne qu’il reçoit. Simplement il y a une différence qui, à chaque fois, est à mesurer ; à savoir qu’il est seul face à son acte, seul avec le dire qu’il a à produire, seul face à l’interprétation qu’il a à délivrer, seul face à la portée que prend ou peut prendre sa parole.
Pour ce faire, le transfert est primordial, c’est le point d’appui qu’il s’agit de faire exister. Pour qu’il y ait transfert, il faut que le praticien prenne une place dans le monde de celui ou celle, enfant, adolescent ou adulte, qui vient lui parler.
Comme nous le verrons avec Madame D., ce dont témoigne Céline Guédin, psychologue d’orientation lacanienne, qui la reçoit dans le cadre d’un C.M.P., il y a à établir les conditions du transfert, ses possibilités. Tout d’abord, il y a une intervention inaugurale de sa part : en l’examinant nous verrons sa valeur d’interprétation par sa portée transférentielle. Elle permettra d’emblée rapidement le déploiement nécessaire d’une chaine cruciale de paroles pour ce sujet particulièrement embrouillé par un réel – où s’entremêlent dangereusement paroles et passage à l’acte –, causé par une jouissance mortifère qui la submerge lorsque dans ses relations aux autres, son corps en est percuté.
Serge Dziomba
Ce séminaire est organisé sous la responsabilité de Marie-Hélène Doguet-Dziomba.
Il aura lieu les mercredis 22 novembre, 20 décembre 2023, 24 janvier, 27 mars, 17 avril, 29 mai 2024 à 20h30.
Ces séances auront lieu en visioconférence.
Participation aux frais : 5 € par soirée ou 25 € pour l’année et pour l’ensemble des séminaires proposés par l’ACF-Normandie. Réduction de 50 % pour les étudiants.
Contacter Marie-Hélène Doguet-Dziomba pour obtenir des renseignements et s’inscrire
Revenir à L’ACF-Normandie » ou à l’Accueil du site ».
Accéder à l’Agenda ».